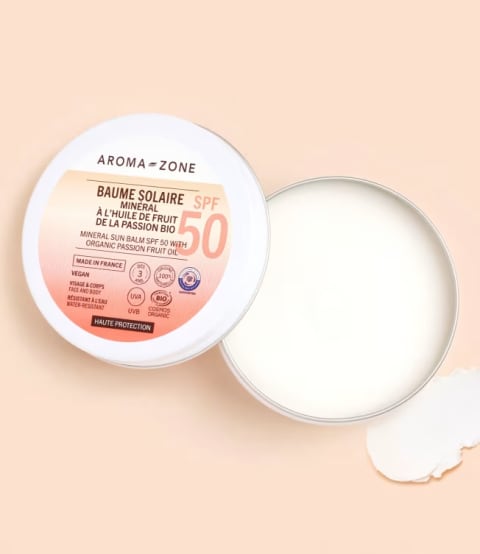Ingrédients (sans balance)
Préparation
1
Mélangez l'ensemble des ingrédients dans un bol.
2
Re-transvasez le mélange dans le pot ou le flacon qui contenait la crème neutre désaltérante.
Nota : le pH de cette préparation est d'environ 4,5-5.
Stockez votre flacon ou pot à l'abri de la lumière et de la chaleur.
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 3 mois.