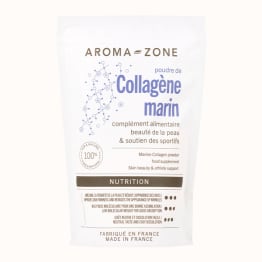Les recommandations médicales consistent d’abord à poser un diagnostic précis : examen clinique, analyses sanguines, vérification des urines et éventuellement une échographie abdominale. Le purpura rhumatoïde étant souvent bénin chez l’enfant, la prise en charge se concentre sur la surveillance des reins et le soulagement des douleurs. Chez l’adulte, il faut prêter une attention particulière aux éventuelles complications, car les manifestations rénales peuvent être plus prononcées.
Repos et suivi régulier : Un repos adapté favorise la récupération. Parallèlement, le suivi médical doit inclure la recherche de signes de néphrite ou d’aggravation.
Médicaments anti-inflammatoires : Les médecins peuvent prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) pour apaiser l’inflammation des articulations. Dans certains cas, des corticoïdes sont envisagés si les symptômes sont intenses ou si la fonction rénale est compromise.
Surveillance rénale : Des analyses d’urine répétées sont recommandées pour détecter précocement une complication rénale.
Mesures d’hygiène de vie : Une bonne hydratation, un sommeil suffisant et une alimentation équilibrée constituent des mesures essentielles pour soutenir l’organisme durant l’épisode inflammatoire.
Le purpura rhumatoïde peut récidiver, c’est pourquoi les médecins préfèrent un suivi sur le long terme, afin d’intervenir rapidement si de nouveaux symptômes apparaissent.